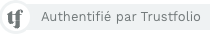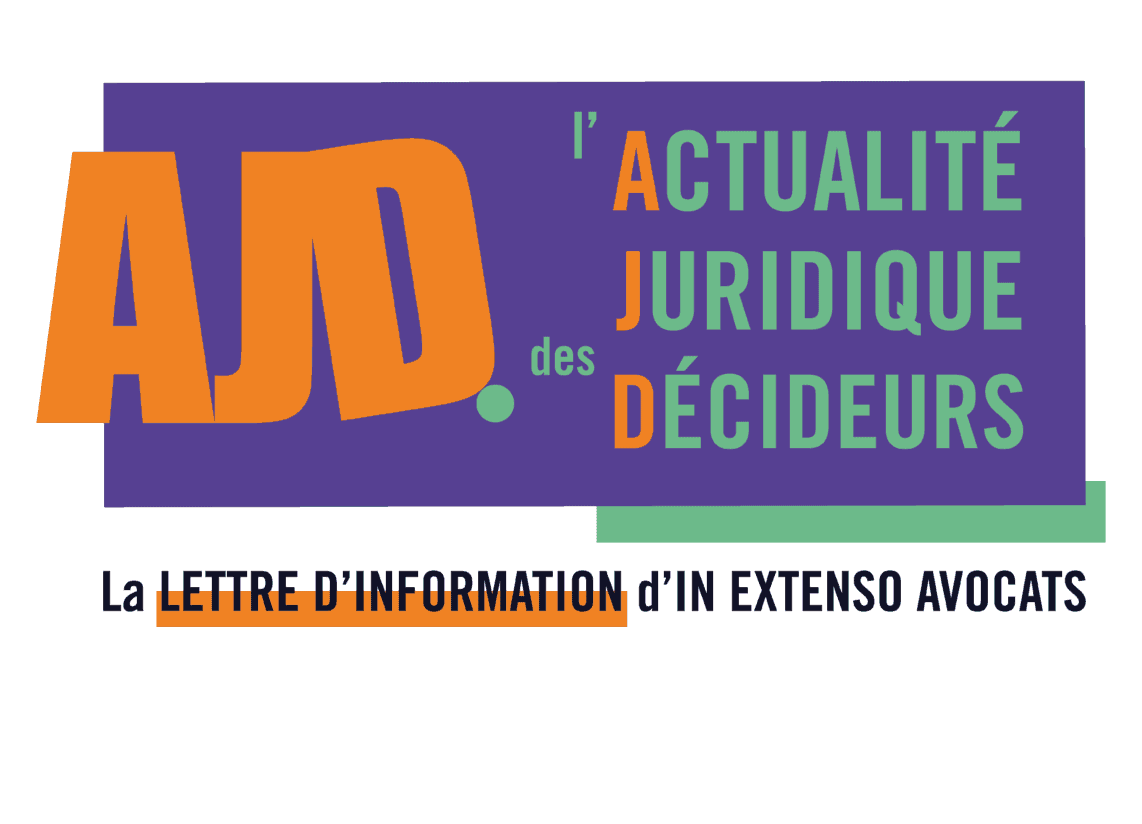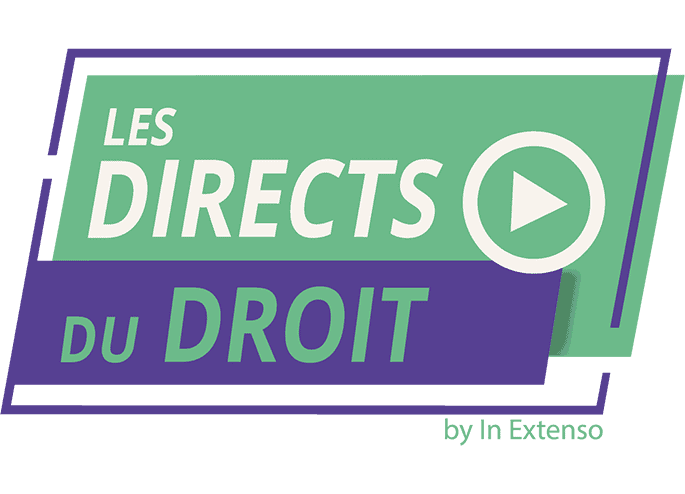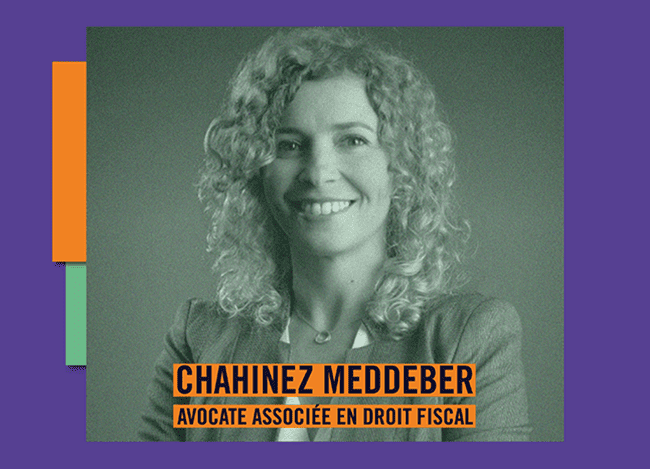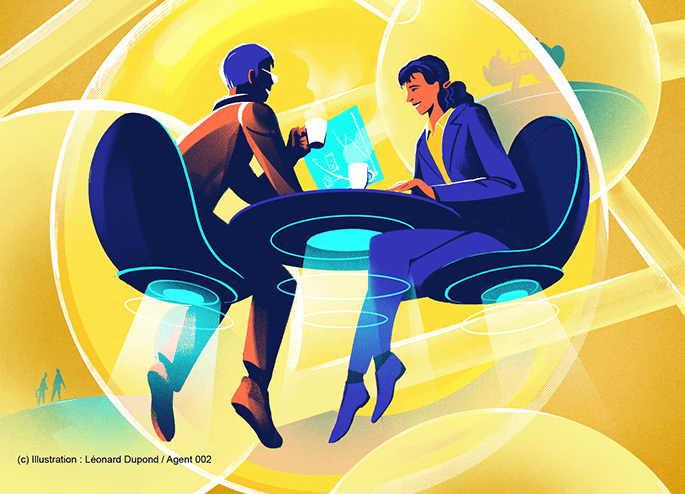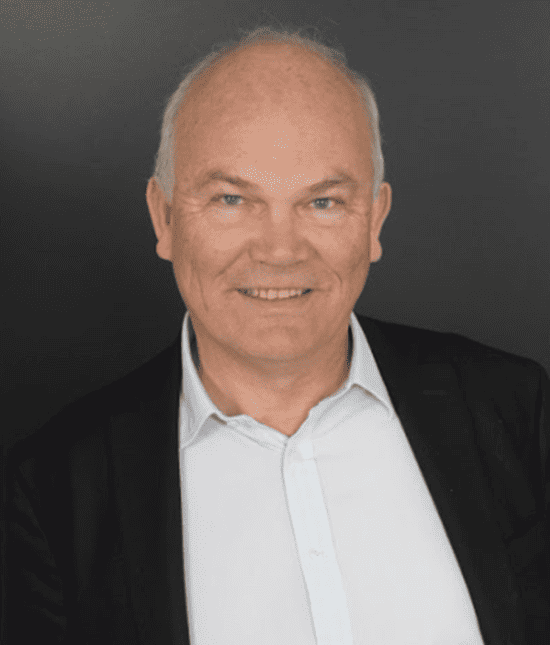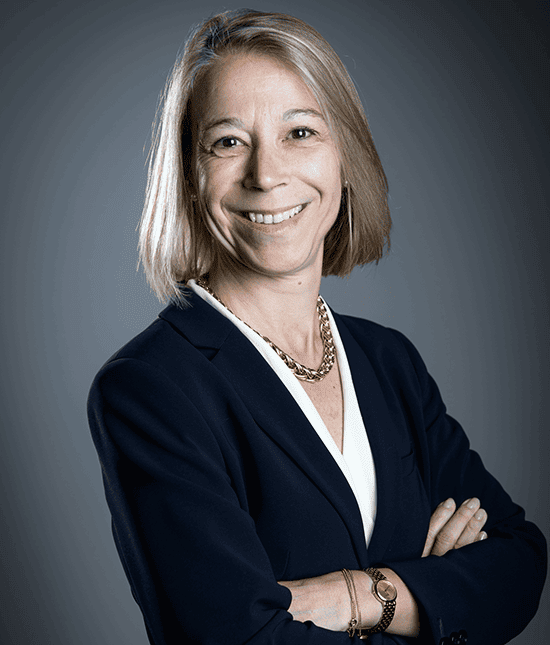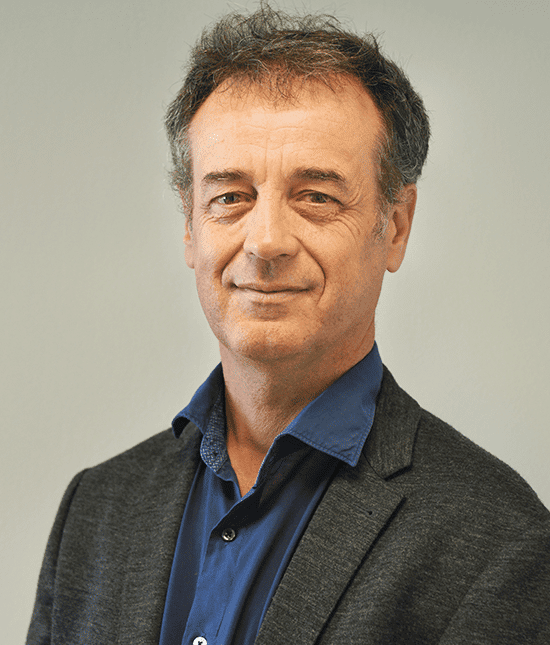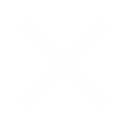Un réseau national
1er réseau de cabinets d’avocats d’affaires pluridisciplinaire et interprofessionnel en France lors de sa création en 2015, In Extenso Avocats accompagne les TPE, PME et décideurs publics et privés sur l’ensemble du territoire national quel que soit leur secteur d’activité.