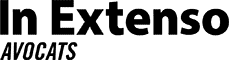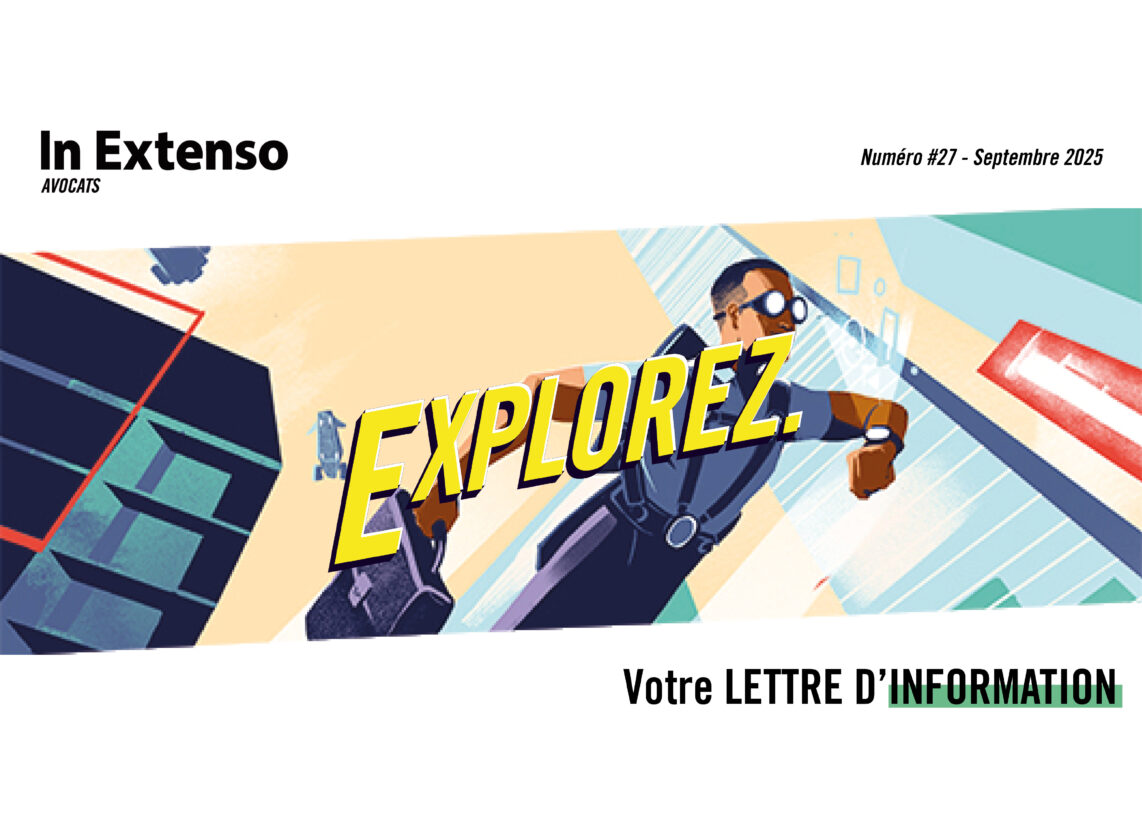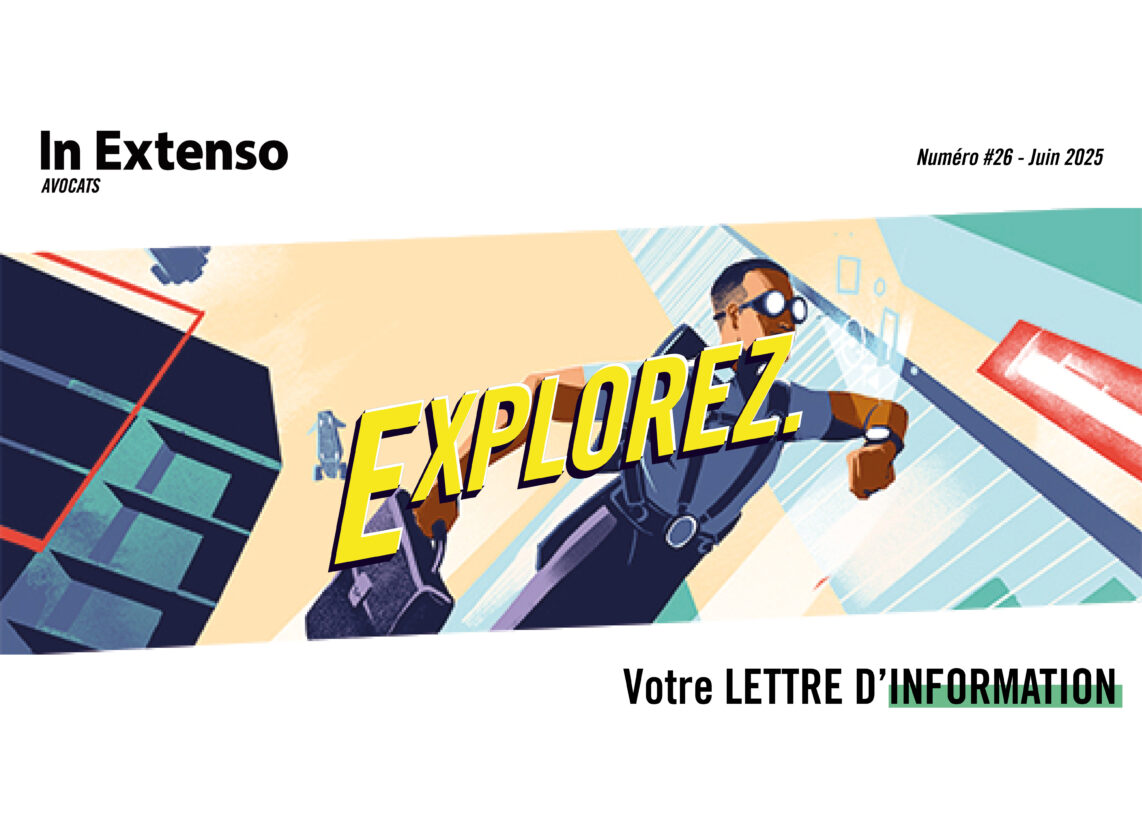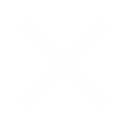Congés payés : le capharnaüm se poursuit !
Date de publication : 15.09.25

 Stanislas Dublineau
Stanislas Dublineau
 Thibaut de Leiris
Thibaut de Leiris
Deux arrêts rendus le 10 septembre 2025 bouleversent radicalement les règles applicables en matière de congés payés.
Après avoir reconnu, en application du droit européen, que les salariés en arrêt maladie continuent d’acquérir des congés payés, la Cour de cassation poursuit son rapprochement avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Malheureusement prévisibles, ces décisions n’en demeurent pas moins problématiques, notamment au regard de leurs conséquences, directes et indirectes.
Un salarié malade pendant ses congés payés peut les reporter
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger leur report, l’employeur s’étant déjà acquitté de son obligation à son égard (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907).
Dans sa première décision du 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et estime désormais que :
« Il résulte de l’article L. 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie. »
Seule limite posée par la Cour : le salarié doit notifier son arrêt maladie à son employeur.
Cette décision reprend un principe anciennement posé par la CJUE, selon lequel la finalité des congés payés est de permettre au travailleur de se reposer et de bénéficier d’une période de détente et de loisirs. À l’inverse, le congé maladie vise à permettre au salarié de recouvrer sa santé (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06). Il ne doit donc pas y avoir de confusion entre ces deux périodes de suspension.
En droite ligne avec le droit européen, cette décision soulève toutefois de sérieuses difficultés :
- D’une part, elle intervient dans un contexte de déficit chronique des comptes de la Sécurité sociale. Était-il opportun d’alourdir encore les charges pesant sur notre système d’assurance maladie ?
- D’autre part, les employeurs sont parfois confrontés à des arrêts maladie injustifiés, voire falsifiés. Or, en période de congés, les difficultés de contrôle sont accrues. Des arrêts peuvent par exemple être délivrés à l’étranger : dans ce cas, comment en vérifier la régularité ? L’enjeu est considérable et semble pourtant totalement occulté par les juges.
Enfin, cette décision risque d’accroître sensiblement la durée d’absence des salariés, alors même que leur temps de travail est jugé, à tort ou à raison, déjà trop faible.
Un salarié partiellement en congés payés peut bénéficier d’heures supplémentaires
La seconde décision de la Cour de cassation remet en cause un principe jusqu’ici solidement établi : les périodes de congés payés n’étaient pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires éventuelles d’un salarié (Soc., 1er décembre 2004, pourvoi n° 02-21.304).
Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour opère aussi un revirement et considère désormais que :
« Il convient (…) d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine. »
Là encore, la Cour s’aligne sur la jurisprudence de la CJUE. Manifestement consciente des conséquences de cette décision, la Haute juridiction justifie son choix en citant pas moins de six arrêts européens sur le sujet.
Désormais, un salarié ayant pris un ou plusieurs jours de congés payés au cours d’une semaine pourra prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues en travaillant toute la semaine.
Ce principe peut se comprendre pour les salariés qui dépassent régulièrement les 35 heures hebdomadaires et effectuent des heures supplémentaires « structurelles ». En revanche, il soulève des interrogations pratiques pour les salariés travaillant habituellement 7 heures par jour mais qui, exceptionnellement, auraient accompli quelques heures « supplémentaires » au cours d’une semaine partiellement en congés payés :
Faudra-t-il considérer chaque jour de congé comme une journée de 7 heures ?
Ou
Faudra-t-il calculer une moyenne des heures travaillées sur les jours effectivement travaillés ?
Une autre question demeure : quid du calcul des heures supplémentaires sur une semaine comportant un jour férié ? La Cour de cassation ne s’est pas prononcée, laissant planer le suspense quant à un éventuel nouveau revirement de jurisprudence…
Conclusion
Les deux arrêts du 10 septembre 2025 illustrent la volonté constante de la Cour de cassation d’aligner le droit français sur le droit européen. Si cette évolution est juridiquement cohérente, elle accentue considérablement les contraintes pesant sur les employeurs, déjà fragilisés par le contexte économique.
Le statu quo aurait peut-être offert un équilibre plus pragmatique… mais les magistrats du quai de l’Horloge en ont décidé autrement.
Auteurs :
Partagez