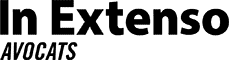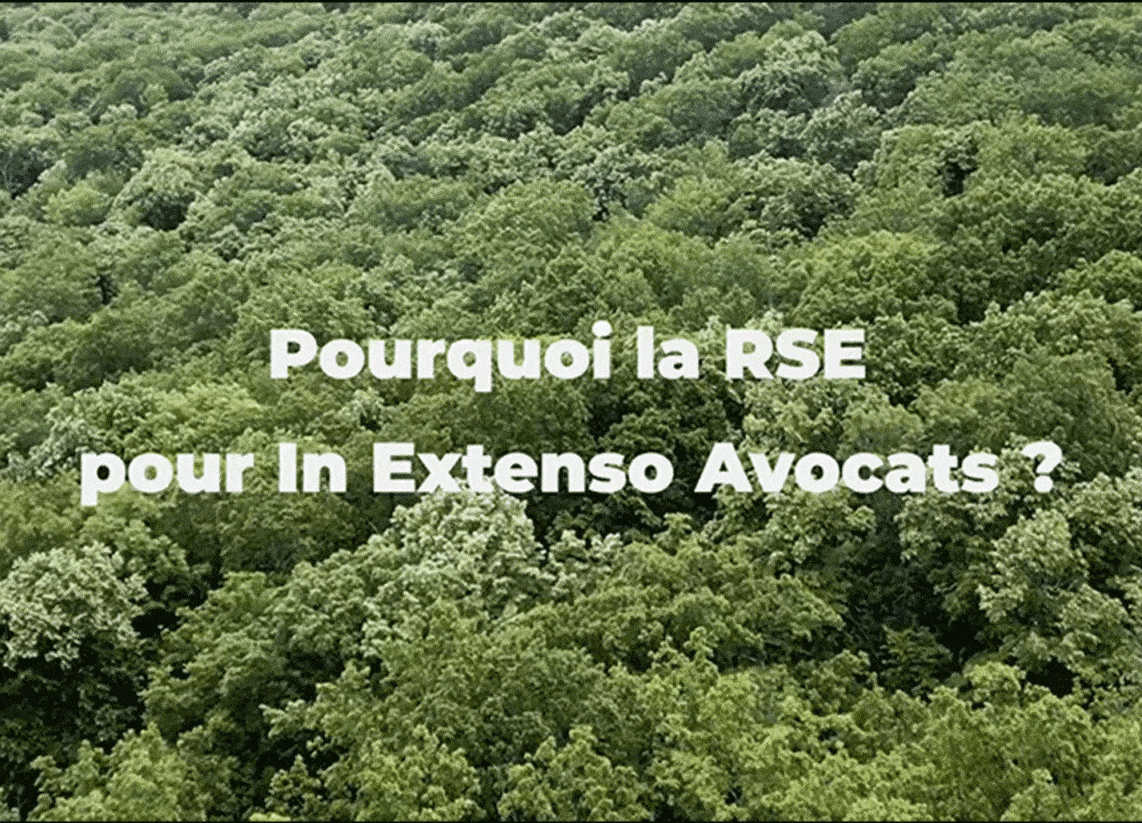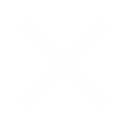La COP26, des avancées suffisantes?
Date de publication : 24.11.21

 Thibault Stephan
Thibault Stephan
La COP26 s’est achevée vendredi 12 novembre à Glasgow sur un pacte conclu entre 196 pays. Celui-ci comporte quelques avancées mais semble largement insuffisant pour enrayer le réchauffement climatique.
Qu’est-ce-qu’une COP ?
La COP est l’acronyme de Conférences des Parties. Il s’agit de la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux.
Prévue par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992, elle se réunit depuis 1995.
Il existe dans le domaine de l’environnement, 3 COP :
● la COP sur la biodiversité
● la COP sur la lutte contre la désertification
● la COP sur les changements climatiques, la plus significative
Dès la première COP, un objectif a été fixé, celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre des Etats participants, renforcé par l’Accord de Paris sur le climat de 2015 qui est venu fixer des étapes clés pour agir contre le réchauffement climatique.
L’exigence actuelle basée sur les rapports scientifiques : maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2° – de préférence à 1,5° – d’ici à 2100.
Quels sont les accords obtenus suite à la COP26 de Glasgow?
Après 15 jours de débats et de négociations difficiles, l’accord trouvé entre les participants contient quelques décisions essentielles.
Deux exemples :
La finalisation des Accords de Paris
L’Accord de Paris est enfin rendu opérationnel et il se trouve doté de règles contraignantes avec notamment l’obligation pour les pays de rapporter leurs émissions de gaz à effet de serre de façon très détaillée et comparable.
La mention des énergies polluantes
Pour la première fois depuis son histoire, la COP reconnaît la responsabilité des énergies fossiles dans le réchauffement climatique.
Les pays sont ainsi appelés à “intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans systèmes de capture (de CO2) et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles”.
Pourtant, la COP26 reste, aux yeux des participants et des observateurs, décevante.
Deux raisons à cela :
- les pays pauvres sont les grands oubliés de l’accord
- Ils sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre et pourtant subissent de plein fouet le réchauffement climatique (tempêtes, incendies, montées des eaux …)
- Ils attendaient de la COP26 un financement spécifique des “pertes et préjudices” qu’ils subissent.
Leur demande est restée lettre morte avec uniquement la promesse de continuer les discussions
- l’échec du seuil des 1,5 °C de réchauffement
Si certaines décisions vont dans le bon sens, aucune n’assure que nous ne dépasserons pas dans les prochaines décennies cette barre pourtant essentielle à la sauvegarde de la planète.
Dans cette période cruciale pour le climat, la COP26 prouve que la politique des petits pas est celle choisie par la plupart des grands Etats. Sera-t-elle suffisante ?
La question qui ne manque pas d’affoler les scientifiques, reste pourtant en suspens.
Retrouvez tous nos articles chaque mois dans l’AJD, l’Actualité Juridique des Décideurs. Abonnez-vous ! 👇

Auteurs :
Partagez